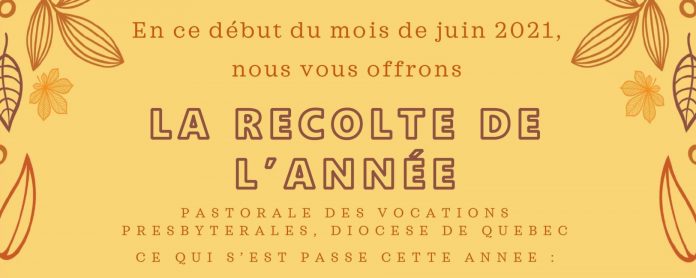Article tiré de la revue Pastorale-Québec, juillet-août 2021
Par Gabrielle Lepage, smnda
L’an dernier, le pape François nous a laissé une parole qui fait réfléchir: « Le coronavirus nous pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux ». Dans cette pandémie de coronavirus, nous découvrons notre responsabilité face à nous-mêmes et nos voisins. Il y là un appel à revisiter ce que nous sommes, avec nos valeurs, et ce que peut devenir la planète; un appel également à mieux penser à l’autre, à mon voisin d’à côté, à mon voisin d’en face, cet autre qu’on a un peu oublié.
Au milieu de cette tempête inattendue, nous sommes tous dans le même bateau, même dans notre diversité. Nous sommes toutes et tous incités par les circonstances à ramer dans la même direction. Nous sentons, nous éprouvons, le besoin de nous réconforter les uns les autres. Ici me vient à l’esprit cette question que l’on retrouve en Isaïe 6,8 : « Qui enverrais-je? » Qui enverrai-je, se demande le Seigneur, pour soutenir l’un et l’autre, pour encourager les autres? Dans ce passage biblique, le nouveau prophète répond aussitôt : « Me voici Seigneur, envoie-moi, sans retard, sans réserve, sans retour ».
Jésus le Christ, aujourd’hui, pourquoi faire?
Eh bien, c’est Lui et Lui seul qui nous a appris que nous appartenons à la même famille de Dieu qui est notre Père, qui nous aime inconditionnellement et gratuitement. C’est Lui qui nous a aimés le premier, ne l’oublions pas. Il peut nous arriver souvent d’entendre dire que ce qui est premier et fondamental dans la vie chrétienne, c’est d’aimer Dieu et son prochain. Ce n’est pourtant pas vrai! Ce qui est premier dans la vie chrétienne, c’est la découverte formidable que le Dieu de Jésus nous a aimés et nous aime encore le premier. Il nous aime telles et telles que nous sommes aujourd’hui, et non pas tels que nous pourrions être. Il nous aime en tout temps, tous les huit milliards et demi d’humains sur la terre.
C’est lui, Jésus le Christ, qui, dans les Évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, nous répète sur tous les tons que le nom de Dieu est Amour et qu’il ne peut qu’aimer.
« Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru » (1 Jn 4,16). Saint Paul dit la même chose, en ses mots: « Je poursuis ma course, laissant tout derrière moi, parce que j’ai été saisi par le Christ Jésus. J’essaie de la saisir à mon tour. » (Phil 3,7-14)
Parce que j’ai d’abord expérimenté l’amour du Dieu de Jésus pour moi, je suis maintenant capable de répondre aujourd’hui avec enthousiasme à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je? » C’est la gratuité de son amour qui nous saisit, qui nous séduit; c’est cette certitude qui nous rend confiants, nous prend au coeur et nous invite à répondre à son amour.
Une fois que nous avons découvert l’amour profond de Dieu pour nous, dans notre vie d’aujourd’hui, alors nous comprenons pourquoi et en quoi — et d’abord en qui — nous croyons, pourquoi nous espérons, pourquoi nous aimons. Ça nous donne une raison de vivre aujourd’hui. Ça donne un sens, une direction à notre vie; ça met notre vie en mouvement, ça nous rend libres en-dedans, ça nous rend confiants, ça nous donne du souffle, ça nous rend heureux intérieurement, quelles que soient les tempêtes au-dehors: les jugements des autres, les épreuves, les mauvais souvenirs, les rancunes, etc. Lorsqu’on est heureux intérieurement, ça transparaît extérieurement. Nietzche avait bien raison de dire : « Moi, je croirai quand les chrétiens auront l’air plus vivants, plus ressuscités ». Ceci me rappelle le commentaire d’une dame après une retraite paroissiale au Lac Bouchette: « Vous avez une foi déconstipée, vous avez l’air heureuse dans votre peau ». Cette expression m’avait fait sourire et m’avait fait le plus grand bien.
À travers l’actuelle perte de repères
Dans notre monde moderne, la foi en Jésus le Christ semble parfois étrangère; nous pouvons avoir l’impression que nous sommes en perte de sens, de direction. Nous nous demandons parfois si l’Église n’est pas en train de s’effondrer, devant la montée des courants spirituels de toutes sortes, des religions « à la carte » où chacun-e choisit les croyances qui lui conviennent. La question peut se poser: est-ce bien la foi ou la religion organisée qui s’effondre socialement? Nos contemporains distinguent de plus en plus la religion, comprise comme un ensemble de croyances et de pratiques, de la foi qui est adhésion à la personnelle de Jésus. D’où l’interrogation qui s’impose : serait-ce l’essentiel qui se délite ou l’accessoire ?
En référence aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Marie Gendron écrit : « J’aime ces gens étranges, leur raison déraisonne. Ils sont les délinquants de la comédie humaine. Le coeur ne souffre pas d’Alzheimer, il capte l’émotion et oublie l’évènement. Il saisit l’essentiel et néglige l’accessoire, il sent la fausseté des gestes et des paroles, il fuit le pouvoir et réclame la tendresse ».
N’oublions pas le mot célèbre du cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XV1, s’adressant à une Assemblée synodale de 300 évêques en 2001 : « L’Église parle trop d’elle-même et pas assez de Dieu. Notre problème actuel est d’avoir vidé la figure de Jésus Christ ». Une intervention remarquable, et, semble-t-il, mémorable.
En lisant et relisant chaque jour la Parole de Dieu dans les quatre évangiles, en essayant de la mettre en pratique, nous découvrons graduellement à quoi sert de connaître Jésus le Christ, ce que nous donne de vivre Jésus le Christ. Lui qui était en continuel contact avec son Père se savait profondément aimé. Il nous aide à saisir ce qui est le plus important aujourd’hui : ce n’est pas l’argent, ni l’avoir, ni le savoir, ni le pouvoir, mais c’est avant tout la certitude d’être aimé par le Seigneur et par les autres.
Malgré et avec le doute
Nous, gens du 21e siècle, nous sommes un peu comme Thomas, qui, dans une certaine perspective d’intelligence de la foi, nous encourage à poser des questions; il nous autorise à douter, à fuir les demi-mesures, quoi! Bien entendu, nous pouvons aussi tomber dans l’excès du doute, les questions incessantes, alors le Seigneur peut nous dire; « Cessez d’être incrédules et soyez croyants ».
Rappelons-nous les grandes questions que nous nous posons régulièrement: « Pourquoi nous vivons? Pour qui nous vivons? À quoi ça sert de vivre? » Ces questions peuvent trouver leurs réponses en regardant Celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6). En regardant « Celui qui est passé partout en faisant le bien et en guérissant » (Actes 10, 38); en essayant de lui ressembler comme le suggère le beau chant de Patrice Vallée : « Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons nos rues, être ton corps qui revit aujourd’hui, à chaque endroit où servent tes amis ».
Une autre chose importante que le Christ nous a transmise, c’est de passer partout en faisant le bien. Il parcourait la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume de Dieu et guérissait toute maladie et infirmité dans le peuple. Il voit la veuve de Naïm et ressuscite son fils, il choisit ses apôtres, il admire la pauvre veuve qui verse des piécettes d’argent pour le culte, il entend le lépreux qui le supplie de le guérir, il dénonce les hypocrites, il se retire souvent à l’écart pour prier, etc.
Le chant de Robert Lebel, « Fais de ta maison… » rejoint bien cette invitation de Jésus : « Fais de ta maison une auberge qui accueille, reçois les gens comme ils sont sans distinction ». De plus, je me sens aussi très interpellée par cette parole lue un jour quelque part, parole très belle et très exigeante à la fois: « Va donner à mon peuple une idée de qui je suis », dit Jésus. Il semble nous le répéter encore plus ces temps-ci.











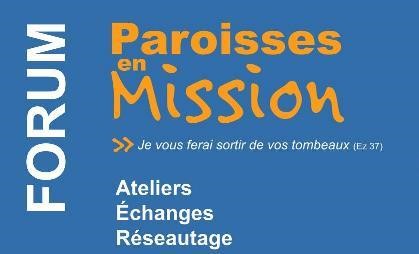

 Daniel Laliberté a été sélectionné pour succéder à M. Éric Sylvestre, P.S.S., à titre de directeur de l’Office national de liturgie. Frère de Mgr Martin Laliberté,p.m.é., évêque auxiliaire à Québec, et originaire de Québec, M. Laliberté est un laïc engagé âgé de 58 ans, marié, père et grand-père. Il a obtenu un doctorat en théologie de l’Université Laval et de l’Institut catholique de Paris.
Daniel Laliberté a été sélectionné pour succéder à M. Éric Sylvestre, P.S.S., à titre de directeur de l’Office national de liturgie. Frère de Mgr Martin Laliberté,p.m.é., évêque auxiliaire à Québec, et originaire de Québec, M. Laliberté est un laïc engagé âgé de 58 ans, marié, père et grand-père. Il a obtenu un doctorat en théologie de l’Université Laval et de l’Institut catholique de Paris.