 Les 11 et 12 septembre prochains se dérouleront les Journées du patrimoine religieux!
Les 11 et 12 septembre prochains se dérouleront les Journées du patrimoine religieux!11-12 septembre 2021 : Journées du patrimoine religieux
 Les 11 et 12 septembre prochains se dérouleront les Journées du patrimoine religieux!
Les 11 et 12 septembre prochains se dérouleront les Journées du patrimoine religieux!Échos du Congrès eucharistique de Budapest
En ce Congrès eucharistique international de Budapest, nous recevons des nouvelles de pèlerins d’ici! Nous les publions sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur cette page, pour le plaisir de partager les découvertes de nos correspondants.
D’emblée, sachez que de nombreux événements du CEI sont disponibles en ligne. C’est le cas de la catéchèse qu’a offerte l’Archevêque de Québec ce 7 septembre. Son sujet, traité en anglais pour l’occasion, porte sur l’eucharistie comme source inépuisable de paix et de réconciliation. Disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=NSNqFp62B-I
Ne manquez pas la Satio Orbis (messe de clôture) présidée par le pape François ce dimanche 12 septembre : https://www.iec2020.hu/fr
Découvrez cette entrevue réalisée par Vatican News, publiée le 7 septembre. 3 septembre: carnet de voyage du Cardinal Lacroix
3 septembre: carnet de voyage du Cardinal Lacroix
 [En direct de Hongrie] Voici quelques idées que Mgr Louis Corriveau et moi retenons de la première journée au Symposium théologique précédant le 52e Congrès eucharistique international. Nous sommes heureux de vous les partager :
[En direct de Hongrie] Voici quelques idées que Mgr Louis Corriveau et moi retenons de la première journée au Symposium théologique précédant le 52e Congrès eucharistique international. Nous sommes heureux de vous les partager :- L’eucharistie est une source. Dans les premières décennies du christianisme, il n’y avait pas les évangiles, pas de théologie développée ou de plan pastoral, mais il y avait l’eucharistie, le Corps du Christ.
- La célébration eucharistique n’est pas seulement une occasion pour refaire nos forces, elle est rencontre avec le Christ.
- L’eucharistie est la source de nos relations. Sans elle, la vie chrétienne s’appauvrit. Jésus parle de la vie quotidienne.
- ‘Goutez et voyez comme est bon le Seigneur.’ Ce refrain bien connu nous dit que le Seigneur se donne à goûter et à voir, d’où la communion et l’adoration.
- Nous contemplons le Christ dans l’adoration et nous sommes reçus par lui.
- Je peux aller à l’adoration même si mon esprit est porté à s’égarer car le Seigneur est là, il ne se sauvera pas, il demeure.
- Même si je suis seul, l’adoration est un acte communautaire. Je suis en présence du Christ livré pour vous.
- Comment aider les fidèles à goûter davantage à l’eucharistie? La contemplation eucharistique conduit à une plus grande compréhension de la révélation chrétienne. Elle fait grandir en nous l’amour du Christ.
- L’eucharistie est une réalité en mouvement: corps livré, sang versé. Jésus n’a pas seulement dit ‘Ceci est mon corps’ mais ‘Ceci est mon corps livré pour vous’, d’où ce dynamisme. Même chose pour la coupe. Il a parlé d’un ‘sang livré pour vous et pour la multitude.’
- La vraie synodalité nous permet de marcher avec Jésus et nous met en route vers la mission.


- L’eucharistie permet d’accomplir la loi de l’amour que nous recevons du Seigneur et de la transmettre aux autres.
- La paix est donnée à toute personne de bonne volonté et doit être partagée avec les autres.
- Le travail qui ne permet pas le repos devient esclavage.
- La patience défait les nœuds et c’est avec Marie que l’on réussit à le faire.
- La vie est un pèlerinage patient. Là où l’Esprit descend, la patience descend inlassablement.
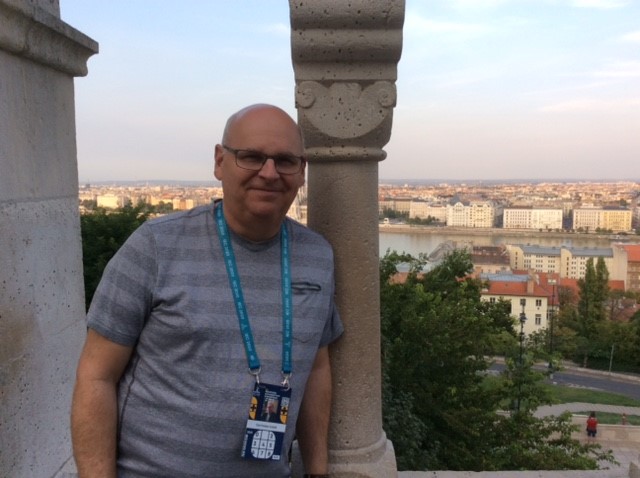

En communion avec l’Église universelle: le CEI de Budapest
2021-22: Une Année pastorale et missionnaire
Article tiré de la revue Pastorale-Québec, septembre 2021
Entrevue avec le vicaire général
L’homme qui déteste entendre « On a toujours fait ça de même! »
Par Valérie Roberge-Dion
Le chanoine Mario Duchesne a été nommé vicaire général au diocèse de Québec en 2019. Deux ans ont passé, deux tours de roue hors norme et déstabilisants. Le bras droit de l’Archevêque pour l’administration du diocèse a accepté de partager ses constats, sa vision, sa motivation.
Depuis votre entrée en poste comme vicaire général en 2019, nous avons vécu de grands bouleversements. Comment qualifiez-vous « l’état de santé » de notre Église diocésaine?
J’ose le dire avec un regard nouveau, parce que j’arrive du milieu paroissial, où j’ai œuvré 27 ans : je considère que le diocèse fonctionne bien. Je découvre aussi plusieurs faiblesses à notre Église diocésaine, dans l’organisation du travail, dans ce qu’on valorise… Au niveau financier, les nombreuses contraintes nous ont montré que l’Église diocésaine doit arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. L’état de santé financier a été encore fragilisé par la crise de la COVID, alors qu’on a vécu un grand ralentissement des activités. On vient de prendre connaissance de l’importance de retrouver un équilibre financier dans tous les aspects de notre travail.
Au niveau pastoral, on est engagés dans un grand tournant missionnaire, qui implique un déracinement de nos habitudes de travail. La fameuse réplique « On a toujours fait ça de même » n’a plus sa place. Nous ne pouvons pas nous permettre un discours missionnaire qui regarde les paroisses et qui n’engage pas le personnel diocésain. Le virage qui est demandé aux paroisses, il doit se vivre aussi au niveau diocésain. Ce n’est pas vrai que l’Église diocésaine va continuer de rester au niveau de l’organisation de la mission «à distance», et de ne pas être sur le terrain de la mission. Les communautés chrétiennes vont expérimenter de nouvelles façons de faire et nous serons là avec elles.
Quel genre de changements pourrait-on voir dans l’organisation des services diocésains, pour aller dans cette direction?
Cette année, pour la première fois, notre chancelier partagera son temps entre les Services diocésains et un mandat en paroisse, comme modérateur d’une unité missionnaire. C’est un exemple concret d’implication sur le terrain qui pourrait se voir dans d’autres champs d’action.
Un des constats que je fais: il n’y a aucun représentant du diocèse auprès d’organismes communautaires de notre grande région. Un virage missionnaire aux services diocésains implique nécessairement une présence et un vécu sur le terrain avec les gens.
Plus globalement, on sait déjà que dans l’avenir, l’organisation diocésaine ne pourra pas être la même. Je pense aux lieux de travail, à la façon de prioriser les chantiers en fonction des besoins évolutifs. On s’est donc lancés dans une réflexion stratégique. Avant la pandémie, il y a eu une première étape de travail avec la direction du diocèse. Nous allons maintenant pouvoir reprendre la démarche, en impliquant d’autres membres de notre communauté chrétienne. C’est très important d’avancer dans cette réflexion pour faire les bons choix pour l’avenir. La structure des Services diocésains n’existe pas pour elle-même, elle existe en soutien à l’Archevêque, dans la réalisation de la mission.
Vous avez été coresponsable de la gestion des mesures sanitaires pour le diocèse. Comment vous sentez-vous au sortir de la crise de la COVID? Qu’avez-vous observé dans nos milieux?
Je remercie grandement Marie Chrétien qui a piloté le gros de l’opération, les communications régulières avec les équipes responsables du déconfinement, une lourde tâche. La crise a mis en lumière certaines faiblesses de notre organisation, mais je dois dire que j’ai vu beaucoup de résilience pour organiser la mise en place des règles sanitaires. Un chantier immense a été réalisé, avec des bénévoles pas toujours jeunes, qui ont gardé le fort. Les actions ont été inégales et variables dans les temps. Certains milieux ont été exemplaires, mais d’autres se sont éteints, avec des églises fermées et tout travail d’équipe sur pause. C’est une souffrance qu’on va traîner longtemps…
La pandémie a été extrêmement difficile pour le moral des troupes. J’ai entendu des gens remettre sérieusement en question leur engagement en paroisse. Dans nos efforts de réorganisation, il faudra rester attentifs et ne pas oublier ce qu’on a vécu, parce que ça risque de ressurgir dans le futur.
Quelle est la couleur de la contribution que vous essayez d’apporter, comme vicaire général?
Très honnêtement, ma contribution à moi, c’est que j’ai spontanément toujours le regard du curé, et non de l’administrateur diocésain. J’essaie d’apporter le regard des paroisses dans tous les dossiers… souvent en confrontant la réalité diocésaine actuelle!
Ça m’influence beaucoup dans mes décisions.
Le cardinal Lacroix m’a demandé de travailler de pair avec lui, de lui apporter un soutien dans la gestion et l’administration. Je le fais avec plaisir, même si c’est une tâche qui me dépasse souvent. Ce n’est pas vrai qu’on a toutes les compétences, mais je me suis donné des moyens d’être supporté, notamment pour la compréhension des documents juridiques qui passent sur mon bureau chaque jour. Je fais ce que je peux en essayant d’avoir un bon jugement, en complémentarité avec les évêques. J’ai gardé depuis toujours la raison première pour laquelle je suis devenu prêtre, dans un esprit de service au cœur de l’Église. Je veux être en état de service dans les besoins actuels et présentement, je rends le service de soutenir l’Archevêque.
Un souhait pour les évêques, au début de cette nouvelle année pastorale!
Je leur souhaite une année plus tranquille, avec moins d’urgences! Qu’ils puissent prendre le temps d’exercer leurs charismes pour la mission diocésaine, sur le terrain. Le cardinal Lacroix est un véritable pasteur, doté d’une grande créativité pastorale. Mgr Laliberté est un formidable accompagnateur pour la réflexion missionnaire dans les communautés. Mgr Pelchat est un solide guide pour notre Église qui se transforme.
Crédit photo : Valérie Roberge-Dion
Pensionnats autochtones : trop de questions encore…
Article tiré de la revue Pastorale-Québec, septembre 2021. Avez-vous pensé vous abonner à ce précieux outil qui accompagne l’Église de Québec dans les transitions qu’elle a à vivre?
Par René Tessier
Début juin, la découverte des restes de 215 enfants dans un cimetière près de l’ancien pensionnat pour jeunes autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique, a créé une véritable onde de choc à travers tout le Canada. Pendant plus de trois semaines, cette présumée « découverte » et les réactions qu’elle suscitait ont fait les manchettes de nos médias; une couverture très exceptionnelle! De plus, même si le pape François a déclaré de Rome que le sort des enfants autochtones traînés de force dans des écoles résidentielles, entre 1883 et la décennie 1990, le préoccupait sérieusement, plusieurs criaient au scandale parce qu’il n’avait pas présenté d’excuses pour ce drame historique. En même temps, on n’apprenait absolument rien sur l’origine des ossements, ce qui aurait pu causer la mort de ces enfants ou à quelle époque ce serait survenu. Aux dernières nouvelles, aucun des corps n’avait encore été exhumé.
Près de trois semaines plus tard, le repérage annoncé d’un semblable cimetière (appelé très improprement, lui aussi, charnier ou fosse commune) dans le sud-est de la Saskatchewan ajoutait de l’huile sur un feu qui, déjà, n’en finissait plus de se consumer. On parlait cette fois d’environ 750 enfants décédés.
Pas vraiment de révélations en la matière
Pourtant, l’existence de ces corps enterrés était bien connue depuis longtemps. Les assises de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), qui a publié son rapport final en 2015, ont permis de relever que, sur les 150 000 mineurs des Premières nations, des Métis et des Inuit qui ont fréquenté les pensionnats pour autochtones, environ 4 000 sont décédés pendant leur séjour1; un nombre relativement accordé aux taux de mortalité infantile dans la société canadienne des débuts du 20e siècle.
Le professeur d’anthropologie à l’Université Lakehead de Thunder Bay Scott Hamilton a personnellement documenté activement, pour la CVR, les cimetières liés aux écoles résidentielles. Dans une entrevue au B.C. Catholic au lendemain de l’annonce médiatique, il soulignait qu’il ne s’agit pas de charnier ni de « fosse commune », comme trop de médias l’ont avancé imprudemment, mais bien de tombes placées les unes à côté des autres, comme dans tous nos cimetières.
Les 4 000 morts de jeunes dans les pensionnats pour autochtones restent toujours à expliquer avec plus de précision. On sait au moins à ce moment-ci que les épidémies, de la grippe dite espagnole à la tuberculose (surtout), la malnutrition, les conditions sanitaires et d’autres facteurs ont joué un rôle important. Selon les époques en cause, le taux de mortalité infantile de ces jeunes autochtones pouvait toutefois être supérieur, égal ou même inférieur à celui des enfants dans la population d’ascendance européenne. On sait encore que le patrimoine génétique des membres des Premières nations les rend traditionnellement plus vulnérables aux maladies apportées par les Blancs; c’est même la première raison du flétrissement de leurs peuples après l’arrivée en Amérique des Européens. De dire le professeur Hamilton : « Certains enfants peuvent avoir été contaminés avant d’être emmenés à l’école, mais la plupart ont pu contracter une infection dans des pensionnats surpeuplés, mal construits et peu entretenus. »
Des tombes non identifiées
Le professeur Hamilton a conclu de ses recherches que les petites croix de bois qui surplombaient probablement les tombes sont tout simplement disparues avec le temps, faute d’entretien. C’est là un élément particulièrement désolant: comme l’observe le jésuite Raymond de Souza dans le National Post, des corps enterrés qu’on ne peut identifier constituent une atteinte à la dignité humaine. Le Gouvernement du Canada, à l’origine des pensionnats pour autochtones, voulait que les dépouilles soient enterrées « au coût la plus bas possible » et n’autorisait pas le retour dans les familles.
C’est probablement cette absence d’identification qui a fait croire un peu vite à certains qu’il s’agissait de fosses communes ou qu’on aurait voulu dissimuler les corps. Nulle part les recherches du professeur Hamilton, qui a consulté les dossiers, ne donnent à penser que les responsables des pensionnats auraient voulu faire disparaître toute trace de ces morts. D’ailleurs, comme ces cimetières sont le plus souvent situés à côté d’une réserve autochtone, il se pourrait qu’on y trouve aussi les corps de personnes, enfants et/ou adultes, décédées sur la réserve. Chose certaine, il faudra enquêter davantage pour déterminer à qui appartenaient les ossements.
Ces derniers, pour l’heure, ont été simplement repérés par un radar à pénétration de sol. Il resterait encore à les exhumer, avec l’accord de la nation concernée (Tk’emlúps te Secwépemc); ce qui ne constitue pas une mince tâche, prévenait dans La Presse du 8 juin la médecin légiste Kona Williams, la première spécialiste sur ce sujet issue d’une Première nation du Canada.
La responsabilité première de l’État
Plusieurs ont trouvé bien démagogique la déclaration du premier ministre canadien, Justin Trudeau, à l’effet que « comme catholique, je suis très mal à l’aise avec le refus de l’Église de présenter des excuses en bonne et due forme ». C’est d’abord oublier trop vite que les pensionnats pour autochtones — et le projet d’assimilation culturelle s’y rattachant — ont été initiés par les autorités fédérales, l’un de leurs plus ardents promoteurs étant le premier des premiers ministres de la Confédération canadienne, John Alexander Macdonald. Le Gouvernement du Canada, résolu à « tuer l’Indien (la culture autochtone) en l’Indien » a tout naturellement confié la gestion des écoles résidentielles à des congrégations religieuses, catholiques mais aussi protestantes; car, à l’époque, c’était elles qui assuraient l’essentiel des services éducatifs au pays. Qui plus est, les responsables de ces pensionnats ont dû se débrouiller, le plus souvent, avec des budgets de misère. C’était particulièrement vrai des sépultures qu’il fallait compléter « au coût le plus bas possible ».
On peut s’interroger sur la manière dont M. Trudeau considère les excuses. Il n’a cessé de présenter des excuses depuis qu’il est premier ministre, au point d’attirer sur lui des commentaires très sarcastiques. On se demande d’ailleurs si ces excuses répétées ne servent pas qu’à tourner la page, sans conséquence pour la suite des choses. Par ailleurs, ça reste toujours un exercice très délicat que de présenter des excuses pour ce que d’autres, collègues, ancêtres ou prédécesseurs, ont pu faire dans le passé.
Le Gouvernement du Canada, alors dirigé par le premier ministre Stephen Harper, avait présenté en juin 2008 des excuses aux survivants des pensionnats pour autochtones. À la suite du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation en 2015, il avait toutefois refusé l’expression « génocide culturel »2, lui préférant une terminologie plus factuelle : « assimilation forcée ». Deux ans plus tôt, en mai 2006, avait été signée la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) : elle accordait à tout ancien étudiant de ces écoles un montant de 10 000 $ pour sa première année de présence et 3 000 $ pour chaque année subséquente. Un processus d’évaluation indépendant (PEI) prévoit la possibilité d’une compensation de 275 000 $, et même de 250 000 $ additionnels en cas de perte de revenu, pour les victimes reconnues d’actes abusifs (sévices sexuels, préjudices physiques graves…) La Commission Vérité et Réconciliation est d’ailleurs née de cette entente.
De multiples reconnaissances des drames vécus
Les communautés religieuses catholiques ont déjà présenté des excuses pour le rôle qu’elles ont tenu dans les pensionnats pour autochtones au Canada. Les Oblats de Marie Immaculée, ceux-là mêmes qui géraient le pensionnat de Kamloops, l’ont fait dès 1991. (Pour être bien précis: l’école de Kamloops était sous la responsabilité du Gouvernement du Canada lors de son ouverture en 1890, les Oblats ont accepté de s’en occuper en 1892 et le Gouvernement en a repris les activités de 1969 jusqu’à sa fermeture en 1979.) D’abord remis à la Commission Vérité et Réconciliation, les dossiers de ce pensionnat se trouvent maintenant au Musée royal de Colombie-Britannique. En tout, 16 des 70 diocèses catholiques au Canada et environ 30 sur une centaine de nos instituts de vie consacrée ont été associés à l’opération des anciennes écoles résidentielles. La rencontre nationale de Saskatoon, du 13 au 15 mars 1991, avait déjà été l’occasion pour les parties concernées de reconnaître la gravité du problème.
Les excuses et expressions de regret de la part de leaders catholiques n’ont pas manqué au cours des dernières décennies. Après les Oblats en 1991, ce furent les allocutions de Mgr Austin Burke, alors archevêque d’Halifax, en l’église Micmac de Sainte-Catherine le 6 décembre 1992 et à celle de la Réserve de Millbrook le 14 février 1993; il citait alors le pape Jean-Paul II s’adressant aux peuples indigènes de Nouvelle-Zélande : « l’Évangile du Christ parle toutes les langues, il estime et embrasse toutes les cultures, il supporte tout ce qu’il y a d’humain en elles… » En 1993, le supérieur général des Jésuites, Hans-Peter Kolvenbach, s’était rendu à De Smet, en Idaho, pour dire aux autochtones des États-Unis : « Les évêques catholiques du secteur ont déjà reconnu publiquement l’insensibilité démontrée par l’Église envers vos coutumes tribales, votre langue et votre spiritualité; je veux ajouter ma voix aux leurs : la Compagnie de Jésus est désolée des erreurs du passé. »
En 2009, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, accompagné de plusieurs délégués des peuples autochtones du Canada, a eu « une rencontre émouvante » avec le pape Benoît XVI au Vatican. Le chef Fontaine avait alors déclaré devant les médias espérer que cela « fermerait le livre » sur la question des excuses aux survivants des pensionnats.
En 1995, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) présentait devant la Commission royale d’enquête sur les peuples aborigènes un document intitulé « Puisse la justice couler comme un fleuve puissant ». On pouvait y lire: « … les révélations troublantes à propos de certains abus commis dans ces écoles-pensionnats nous ont notamment fait faire un sérieux examen de conscience. Solidaires de l’Église dans ses succès, nous devons aussi porter le fardeau de son passé. » Les évêques canadiens précisaient plus loin: « Toutefois, la justice et la guérison concernent non seulement les Églises, mais aussi toute la société canadienne. » Ils rappelaient que, non seulement les écoles résidentielles ont été mises sur pied par le gouvernement canadien mais encore que: « Loin d’être clandestine, cette politique gouvernementale a à maintes reprises, été énoncée ouvertement et publiquement. Elle reflétait la mentalité politique et sociale de l’époque et s’attirait la faveur du grand public. »
« Autres temps, autres mœurs… »
Ce contexte historique est trop souvent méconnu ou oublié. Par exemple, l’Exposition universelle de Paris, en 1938, célébrait en fanfare les bienfaits du colonialisme européen en Afrique et chantait les louanges de la mission civilisatrice peuples de race blanche, venus aux secours des pauvres indigènes pour les aider à mieux vivre. À l’époque, cela paraissait parfaitement normal ou allant de soi. Partout dans le monde, les vertus du colonialisme fondé sur des théories suprémacistes n’ont commencé à être vraiment remises en question qu’avec la montée des nationalismes à la fin de la décennie 1950. Souvenons-nous encore que, dans les six premières décennies du 20e siècle, les corrections physiques étaient monnaie courante dans la plupart de nos institutions d’enseignement.
Ce qui n’empêche pas, comme le déclarait dès le 3 juin le cardinal Thomas Collins, que : « L’abus des peuples autochtones est un sombre chapitre de l’histoire du Canada et de l’Église catholique. Bien que l’Église ait soigné et servi les peuples autochtones de nombreuses façons, il est indéniable que certains membres de l’Église ont porté atteinte à la dignité des membres des Premières Nations. »
Vers une éventuelle réconciliation
La réconciliation n’en demeure pas moins incertaine. Les évêques canadiens ont fait savoir qu’une nouvelle délégation de représentants autochtones et d’évêques se prépare, depuis deux ans déjà, pour un long tête-à-tête avec le pape François au Vatican. La pandémie a empêché cette rencontre d’avoir lieu en 2020, tel que prévu initialement. Le dimanche 6 juin dernier, le pape François a exprimé sa « douleur » devant la nouvelle du repérage des 215 corps. Il a tenu à affirmer sa « proximité » avec toutes les victimes et survivants des écoles résidentielles; en même temps qu’il appelait à se défaire du « modèle colonisateur » et de toutes « les colonisations idéologiques d’aujourd’hui ».
Dans les médias, plusieurs n’en ont pas moins persisté à réclamer du Pape des excuses formelles. (Habituellement, de telles excuses doivent être accompagnées d’importantes compensations financières.)
Diverses sources concordent pour prévoir en novembre prochain la visite à Rome des trois délégations canadiennes annoncée par la CECC : outre quelques évêques, des représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuit; on devrait y trouver un bon nombre d’aînés ou « gardiens du savoir », de survivants des pensionnats et de jeunes. Les trois délégations rencontreront d’abord le Pape séparément avant d’ensuite se retrouver toutes les trois ensemble.
Certains évêques ont déjà déclaré qu’ils espéraient que le Saint-Père formule des excuses au nom de l’Église universelle. Il reste à voir, cependant, dans quelle mesure cela pourrait permettre d’enfin tourner une page bien douloureuse.
1 Le juge d’origine autochtone Murray Sinclair, qui a dirigé les audiences de la Commission Vérité et Réconciliation, déclarait en 2015 qu’il pourrait y avoir jusqu’à 6 000 enfants morts dans les écoles résidentielles.
2 Le droit international ni aucun pays du monde n’ont jamais reconnu ce concept étrange de « génocide culturel ». Il comporte une risque aussi grave qu’évident, celui de basculer rapidement vers l’emploi à tort et à travers du terme « génocide ». C’est une appellation réservée à des situations extrêmes de massacres à grande échelle comme la Shoah ou le massacre des Juifs par les Nazis (1941-45) et le génocide arménien qui a culminé en 1915. Certains ajouteront les deux millions de morts du Cambodge sous Pol Pot (1975-79) et le million de morts au Rwanda en 1995. Mais tout le monde refuse d’associer ce terme même à des opérations d’épuration ethnique d’une extrême sauvagerie comme celles menées dans l’ex-Yougoslavie. Du reste, il y aurait une contradiction totale entre la volonté d’exterminer et d’éradiquer un peuple et un projet comme celui des pensionnats autochtones.
Lancement de l’année pastorale missionnaire : une formule dynamique et innovante
 Nous sommes déjà dans les préparatifs qui nous conduiront au lancement de la prochaine année pastorale missionnaire. Inspirés par le renouveau vécu au cours des dernières années, nous vous proposons à nouveau une formule dynamique et différente, ajustée à la situation actuelle!
Nous sommes déjà dans les préparatifs qui nous conduiront au lancement de la prochaine année pastorale missionnaire. Inspirés par le renouveau vécu au cours des dernières années, nous vous proposons à nouveau une formule dynamique et différente, ajustée à la situation actuelle!
« Je vous invite à réserver cette journée à votre agenda et à rassembler les forces vives de vos milieux afin qu’avec le souffle de l’Esprit du Christ ressuscité, nous puissions vivre ensemble sur la route de la mission en cette nouvelle année pastorale missionnaire 2021-2022. Au plaisir de vous rencontrer ! »
– Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
Le rendez-vous principal « grand public » sur ECDQ.tv :
Ce samedi 25 septembre prochain, de 9 h 30 à 11 h 30, tous les diocésains et diocésaines sont conviés à se connecter sur notre webtélé ECDQ.tv. Notre Archevêque et son équipe nous y donnent rendez-vous, pour une webdiffusion qui vise à apporter élan et orientation, en cette rentrée. Pourquoi ne pas inviter un ou une autre membre de notre communauté chrétienne chez vous pour visionner l’événement, si les conditions sanitaires le permettent? Branchons-nous sur www.ecdq.tv, ou sur la page Facebook ou Youtube d’ECDQ.tv.
Pour les leaders de communautés chrétiennes, un mode hybride :
Un grand rendez-vous diocésain pour lancer l’année pastorale missionnaire avec tous les leaders en Église aura lieu le Samedi 25 septembre. Ce sera une formule « hybride » :
En matinée : de 9h30 à 11h30, nous nous branchons sur l’événement qui sera webdiffusé sur ECDQ.tv. Les unités pastorales et les paroisses organiseront des lieux satellites où des leaders des communautés chrétiennes seront conviés à vivre ce lancement « ensemble ».
En après-midi : de 13h30 à 15h, des rassemblement « locaux » dans les lieux satellites avec des leaders pour échanger et préparer ensemble cette autre année de mission!
→ Lien de connexion : ecdq.tv
Réservons donc nos agendas pour ce moment important de la vie de notre Église… en mission!
Commission sur l’évolution de l’aide médicale à mourir
Un nouveau numéro de Vivre et célébrer: la nouvelle traduction du Missel romain
Le Missel romain, livre par excellence de la célébration eucharistique! Bientôt sera implantée la traduction de la troisième édition de référence en latin (ou « typique »).
Dans ce numéro de la revue Vivre et célébrer, vous découvrirez ce missel et ses secrets, de l’immense travail de traduction à la confection du livre. À télécharger ici: https://www.cccb.ca/wp-content…
Saviez-vous que vous pouviez vous abonner à cette revue à l’aide d’un simple formulaire internet? https://www.cccb.ca/fr/liturgi…
L’équipe des Services diocésains est prête pour la rentrée
C’est la rentrée… pour vos services diocésains aussi. Sous le chapiteau, c’est une formule innovante pour la rentrée cette année, et ouverte au souffle nouveau que l’Esprit veut insuffler à notre Église.
Ça faisait du bien de se retrouver… en présentiel! Nous avons pu échanger sur les défis de la dernière année et demie, mais aussi les élans nouveaux qu’elle permet. Nous avons pris le temps d’identifier en équipes sur quelles forces nous voulons nous appuyer pour initier les projets de l’automne. Après avoir partagé des informations importantes et reçu les intuitions de nos leaders, c’est dans l’Eucharistie que nous avons accueilli l’élan pour cette nouvelle année.
Il y en a du cœur à l’ouvrage au service de l’Église de Québec! Certains visages sont connus, d’autres moins, mais tous sont importants. Découvrez-en quelques-uns dans ces images.
Une année pour les familles !
 Avec la pandémie, il y a bien des annonces qui sont passés plus discrètement qu’à l’habitude au cours des derniers mois. Cinq ans après la publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’amour), voilà que le pape Francois a décrété une année consacrée à la famille. Elle a été inauguré le 19 mars dernier et elle se poursuit jusqu’à l’été prochain. Elle se terminera en juin 2022 par la 10e Rencontre mondiale des familles qui se tiendra, comme la première tenue en 1994, à Rome. D’ailleurs, savez-vous qu’un des fruits de cette année est la 1ere Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, tenue le 25 juillet dernier ?
Avec la pandémie, il y a bien des annonces qui sont passés plus discrètement qu’à l’habitude au cours des derniers mois. Cinq ans après la publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’amour), voilà que le pape Francois a décrété une année consacrée à la famille. Elle a été inauguré le 19 mars dernier et elle se poursuit jusqu’à l’été prochain. Elle se terminera en juin 2022 par la 10e Rencontre mondiale des familles qui se tiendra, comme la première tenue en 1994, à Rome. D’ailleurs, savez-vous qu’un des fruits de cette année est la 1ere Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, tenue le 25 juillet dernier ?
Dans le cadre de cette année baptisée « Famille Amoris Laetitia », il nous est proposé d’approfondir ce document papal, mais surtout de le mettre en œuvre ! Des outils pastoraux sont mis à la disposition autant des familles que des communautés chrétiennes.
Voici quelques liens pour vous permettre de découvrir un peu plus ce qui se trame avec cette année toute spéciale :
– Lisez un article pour en apprendre un peu plus : Les 12 propositions du Pape pour accompagner les couples et les familles
– Découvrez les propositions issues de l’exhortation pour une pastorale familiale plus vivante : En chemin avec les familles
– Visionnez les Vidéos d’Amoris Laetitia
Et si certains parmi vous sentaient l’appel à aller à la rencontre du Saint-Père et des nombreuses familles qui y seront, il sera aussi possible de se rendre à cette rencontre internationale à Rome. Restez à l’affut, des forfaits seront disponibles sous peu !
Bonne année « Famille Amoris Laetitia » !!



















