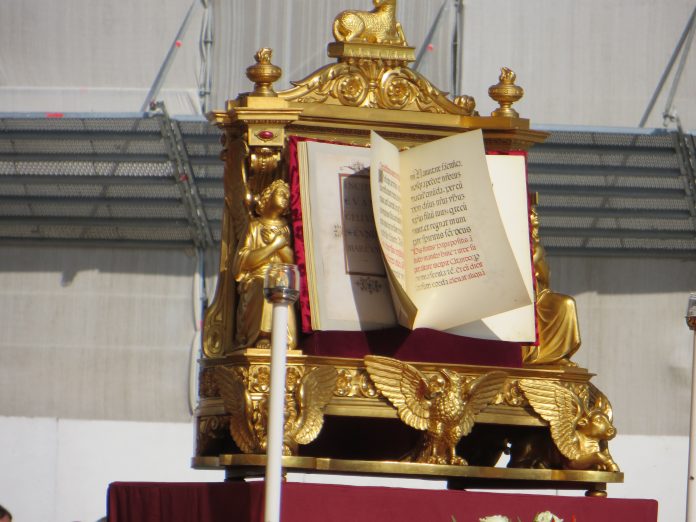Article tiré de la revue Pastorale-Québec, octobre 2021
Par René Tessier
Au départ, l’invitation à une soirée du Grand Prieuré russe de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Québec, dit Ordre de Malte, un groupe dont peu d’entre nous connaissaient l’existence. D’autant plus qu’il se distingue, même si ses membres locaux sont majoritairement catholiques, du Grand Prieuré catholique de l’Ordre de Malte, plus présent dans le reste de l’Église universelle que chez nous, ou de ses rameaux protestant et anglican. Les raisons de cette pluralité sont historiques : en 1798, chassés de l’île de Malte par Napoléon Bonaparte, les Chevaliers de l’Ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem trouvent refuge, certains à Rome et aux alentours, d’autres en Russie, accueillis par le tsar francophile Paul 1er. À la condition qu’ils s’ouvrent aussi aux orthodoxes, Paul 1er accepte de devenir leur grand-maître mais est rapidement assassiné et remplacé par un des Chevaliers exilés, avec l’accord du Pape, dès 1801. La Révolution russe bolchévique en 1917 chassera l’Ordre de Malte du pays des steppes, bon nombre de ses membres trouveront refuge en France, quelques-uns au Québec. Selon son site internet, le Grand Prieuré russe compterait 250 dames et chevaliers dans le monde.
C’est l’abbé Pierre-René Côté, son chapelain à Québec, qui avait suggéré d’inviter, en cette soirée du 27 août, le jeune (40 ans) Grand Chef des Atikamekws d’Opitciwan: Constant Awashish. Avocat de formation, celui-ci passe pour un homme de dialogue, qui a toujours recherché la conciliation tout en plaidant ardemment pour les droits de sa nation. Il est aussi le premier autochtone à être devenu colonel honoraire d’un régiment canadien, le 62e régiment d’artillerie de Shawinigan.
Histoire compliquée, aux maints rebondissements
L’initiative de l’abbé Côté et du Grand Prieuré s’inscrit évidemment dans le contexte de la crise des pensionnats autochtones au Canada. Elle tient compte aussi des relations corsées, sur fond de revendications et de difficile réconciliation, entre notre société principalement de souche européenne et nos Premières nations. On avait intitulé cette soirée: « Les perceptions autochtones — Entre réalité historique et nécessaire réconciliation » (C’est nous qui surlignons en gras).
Excellent communicateur, Constant Awashish s’est dit d’abord timide, un peu gêné devant l’ampleur du défi : résumer et commenter « une histoire très complexe ». Comme pour s’excuser d’entrée de jeu, il reconnaît que l’expression des revendications traditionnelles par les autochtones « n’est pas toujours agréable »; mais il ajoute aussitôt ce qu’il répétera à quelques reprises: « chaque fois que nous voulons discuter sérieusement de territoire ou de ressources naturelles, les gouvernements se dépêchent de brandir publiquement des épouvantails pour effrayer la population ».
Remontant à l’arrivée de Jacques Cartier, qu’il situe en 1535, M. Awashish rappelle que « les Français ont été accueillis à bras ouverts » et même secourus dans le besoin: « ils étaient de petite taille, frêles et dépourvus » face au climat et au manque de nourriture. Il souligne rapidement que « les sociétés européennes ont apporté beaucoup en Amérique » mais aussi que « leur arrivée a suscité de multiples tragédies ». Néanmoins, nouveaux et anciens habitants du Canada ont collaboré « pendant des siècles »; du moins jusqu’à l’Acte de l’Amérique nord britannique, le pacte fédératif créant le Canada en 1867, qui mettait de côté les autochtones. Celui-ci fut rapidement suivi de la Loi sur les Sauvages de 1876, renommée par la suite Loi sur les Indiens et amendée plusieurs fois.
Le Grand Chef atikamekw relève qu’en 1896, un juge canadien faisait observer, dans une déclaration de type « en passant » (donc sans conséquence immédiate), que les peuples autochtones ont eux aussi des droits; apparemment, la première mention juridique. Longtemps après cela, le jugement Calder en 1969 établit en Cour suprême, à partir d’une requête de la nation Nisga’a de Colombie-Britannique, que « les titres fonciers des Autochtones comme étant un droit découlant de l’occupation des territoires traditionnels » (L’Encyclopédie canadienne). Cette percée sera confirmée par au Québec par le jugement Maalouf en 1973 : celui-ci donne raison aux Cris et ordonne la suspension des travaux de la Baie James. (On sait que les Cris, alors dirigés par Matthew Coon Come, obtiendront ensuite d’importantes compensations contre l’érection de barrages sur leur territoire.) Malgré ces victoires juridiques, Constant Awashish fait remarquer que « la Cour suprême ne peut pas aller à l’encontre de la Constitution canadienne ».
On sait que celle-ci a été rapatriée et modifiée en 1982, sans l’accord du Québec. On y a inséré la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 35, qui « reconnaît et affirme explicitement les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Il précise également que le terme « peuples autochtones du Canada » comprend les Premières nations, les Inuits et les Métis du Canada. » (L’Encyclopédie canadienne)
Notre témoin conclue cette première partie en insistant sur le fait que son peuple « négocie depuis plus de 40 ans », mais que les discussions piétinent, surtout à propos contrôle du territoire et des richesses naturelles…
La douloureuse histoire des écoles résidentielles
On avait expressément demandé à Constant Awashish d’aborder l’épreuve historique des pensionnats autochtones. Sa mère, des tantes et des oncles y sont allés. Ces écoles ont ouvert leurs portes, pour sa nation, seulement entre 1950 et 1955, et les ont fermées en 1996. Notre conférencier indique qu’il « ne faut pas généraliser », tout en soutenant que « des gens ont su profiter de la situation ». Il raconte deux situations, qu’on peut qualifier d’horribles, auxquelles sa mère dit avoir personnellement assisté.
Pourquoi, alors, les autochtones sont-ils restés en lien avec l’Église catholique? Parce que, d’après lui, « ce sont des gens tellement croyants naturellement ». Ce qu’a rapporté la Commission Vérité et Réconciliation ne serait-il vraiment « que la pointe de l’iceberg » ?
Quoi qu’il en soit, le jeune grand chef maintient qu’il faut « reconnaître les atrocités commises, mais aussi savoir reconstruire par-dessus ». Il estime que nos peuples partagent des valeurs communes dans une proportion de 90%. Il déplore que la participation active de nombreux autochtone dans nos guerres ait été vite oubliée, voire passée volontairement sous silence. Le Canada possède « d’immenses ressources naturelles » qui pourraient faire de nous un jour une cible de choix; si la question des territoires était réglée au préalable, « nos peuples pourraient alors faire face ensemble ».
Solides interventions de l’assemblée
On demande d’abord à Constant Awashish pourquoi toutes les tentatives d’abroger la Loi fédérale sur les Indiens ont avorté au fil des ans. Il reste discret sur les négociations elles-mêmes, dont on sait qu’elles mettent en cause des tribus ou nations aux intérêts différents, mais il épilogue rapidement; « Grâce à ça, nous pouvons exister encore ». Bref, il n’y a pas que des inconvénients à constituer un peuple séparé…
Notre témoin reconnaît que « même certains autochtones sont des extrémistes »; ce qui permet au maître de cérémonie d’ajouter : « Nous aussi, les francophones, nous sommes très minoritaires en ce pays, c’est grâce au clergé que nous avons pu globalement préserver notre langue et notre culture ». L’un et l’autre conviennent aisément que la perspective d’échanges et d’enrichissement réciproques devraient circuler davantage.
Ceci dit, le jeune chef atikamekw réitère que les territoires n’ont été « ni cédés ni conquis », faisant l’impasse sur l’absence de la notion de propriété du sol dans les pratiques ou traditions des Premières Nations. L’avocat de formation a découvert que, jusqu’en 1969 au Canada, il était interdit aux membres du Barreau de défendre des autochtones en Cour.
À propos de son ton très serein, il nous déclare : « Je me sens très bien dans le Canada actuel mais trop de gens, au sein de nos peuples, se sentent mal. » Le chef des Atikamekw évalue à 8 000 la population de sa communauté. Sur le territoire dont il a proclamé la souveraineté au lendemain de son élection en 2014, la principale ressource est la forêt, dont même les papetières s’inquiètent pour l’avenir. Mais comment peut-on, comme il le suggère, faire coexister côte à côte deux systèmes juridiques? Réponse; « En Inde, il existe bien un millier d’ordres juridiques ».
« Ce n’était qu’un début, cette rencontre », de dire l’abbé Pierre-René Côté, en guise de conclusion temporaire. « Apprenons à écouter, de part et d’autre, pour mieux comprendre »; dans le but avoué de mettre fin à « l’estrangement » (l’isolement et l’ignorance mutuelle) mis en place historiquement par la Couronne britannique.
Pour poursuivre la démarche, le chapelain nous recommande la lecture du livre de James Daschuk, La destruction des Indiens des Plaines (Presses de l’Université Laval, 2015, pour la version française). En bon étudiant, nous l’avons consulté. Deux extraits, choisis rapidement à travers une remarquable synthèse :
Après l’épidémie (de variole du début des années 1780), le brassage des populations, survivantes et nouvellement arrivées, donne naissance à de nouvelles identités collectives par ethnogenèse: Cris des Plaines; Ojibwés de l’Ouest, ou Saulteaux; elle stimule l’émrgence de la culture des Métis des Plaines. (NDLR : Ceux-ci se révolteront un siècle plus tard contre la confiscation de leurs terres, sous la direction de Louis Riel et Gabriel Dumont, mais seront défaits par la Police montée du Nord-Ouest, alors naissante). (P. 95)
(Autour de 1881) Malgré l’aggravation de la crise (alimentaire et médicale), le Dominion ne débloque pas un sou de plus pour y remédier. (…) Sir Leonard Tilley, ministre des Finances, résume en quelques mots la nouvelle politique : « Soit ils travaillent, soit ils auront faim ». (…) Pour saper la résistance grandissante des populations signataires de traités, les provisions sont distribuées uniquement aux groupes installés dans leurs réserves. (P. 223)
Une longue histoire que nous n’avons pas fini de découvrir? Oh, que si!